"Chantiers", de Marie-Hélène Lafon

Ce livre de Marie-Hélène Lafon répond à une commande des éditions des Busclats qui aiment publier des écrivains reconnus auxquels est demandé de "faire un pas de côté". Avec son récent Traversée (1), l'auteure avait déjà expérimenté le cadre contraint et y avait pris goût, écrivant dans la foulée plusieurs petits textes (sur les classes sociales, l'éducation religieuse, Flaubert ou Claude Simon ...) lui permettant de "mettre l'écriture à distance". Des "chemins de traverse" qui aboutirent à ce livre.
Chantiers est à vrai dire moins un pas de côté en marge de son oeuvre que plusieurs petits pas tournant autour de sa construction. sa formation et sa lente maturation d'écrivain, évoque ce qui l'a nourrie, ce sur quoi et ceux sur qui elle s'est adossée, nous invite sur ses chantiers d'écriture pour nous dévoiler ses matériaux et nous détailler de manière passionnante les nombreuses possibilités de ses outils, ou pour nous expliquer le rôle d'affûtage préparatoire de ces «musiques d'établi» - dont Bach est le grand maître - qui la mettent «en état de vertige têtu et d'urgence jubilatoire» pour monter à l'assaut. Et ce faisant, elle approche le fondement-même de son écriture, écriture qui est pour elle l'épicentre du séisme vital.
L'éblouissement des mots
L'école primaire offre à l'auteure l'éblouissement des mots, la révélation de la grammaire qui permet le «déchiffrement du monde», lui donne sens, chaque pièce trouvant alors «sa juste place». C'est une période d'appropriation des outils de la langue. De ces outils «ni lourds ni froids» que «l'on porte en soi», et dont la maîtrise donne la jouissance enivrante de la puissance : «On est souverain, on a au moins cette puissance».
C'est une première renaissance, et ce désir d'école la poussera toujours plus loin, débouchant, après la jouissance de la lecture, sur un désir d'écriture. Mais l'auteure n'osera «se mettre à l'établi des mots, de la phrase, du texte» pour «empoigner» la «matière-même du monde» que bien longtemps après avoir étudié les lettres classiques (3) et entamé une carrière de professeur. Elle commencera enfin «à soupçonner que les écrivains ne sont pas tous morts» et sa rencontre avec les livres de Richard Millet, Pierre Michon et Pierre Bergougnioux, «trois forçats du verbe, éperdus des origines» qu'elle nomme malicieusement son «triangle des Bermudes», s'avèrera capitale. Une mise à l'écriture tardive qui exacerbera chez elle le sentiment d'«urgence» : «Je n'aurai pas trop de ma vie "pour aller au bout de moi même"».
3) Elle commence à écrire à 34 ans et publie son premier livre, Liturgie, envoyé à Pierre Michon qui l'encourage à continuer, en 2001, à l'âge de 39 ans
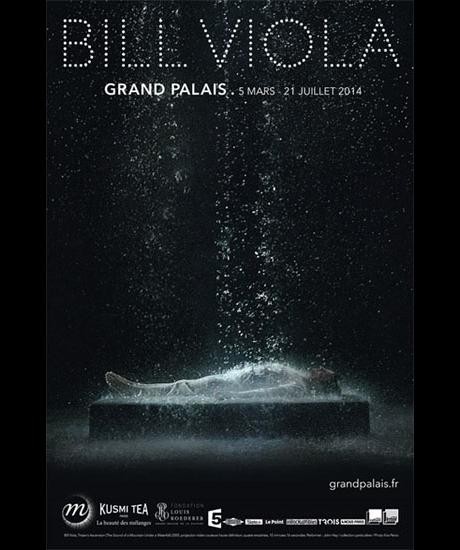
«un sculpteur du temps, du temps en mouvement,
du temps à l'oeuvre dans la matière des corps»
Marie-Hélène Lafon puise sa matière dans ce «limon des origines» de la haute et rude vallée de la Santoire où elle a été «plantée», où elle a grandi en s'enracinant lentement, profondement, développant un rapport au monde très physique, très organique. Dans un lieu et aussi un milieu : une famille paysanne catholique, propriétaire d'une ferme qui lui «fait honneur» et possédant «la sorte d'orgueil qui va avec», mais marquée par la conscience d'appartenir à un monde «périmé» - comme dit le père – et qui n'en finit pas de mourir :
«Nous commencions, et la mort était déjà sur nous, nous étions mordus par elle et tellement vivants, éperdus de vie. »
Très tôt s'inscrit ainsi cette tension entre «la mort et la chaleur du sang», entre l'élan vital et la mort scandée par la litanie du père, dont se nourrissent ses livres. Livres d'une auteure se disant avec autodérision atteinte de «chronalgie», refusant «ce temps dardé entre naissance et mort », et lui préférant «des temps mêlés, enroulés, immiscés, des ondes sismiques de temps qui traversent et travaillent au corps à la fois le texte et notre conscience de lecteur ».
D'une auteure qui se souvient aussi de l'humiliation - même si l'humour en transcende chez elle toute amertume – : celle d'un monde rural dévalué et méprisé, au bas des «barreaux de l'échelle sociale», ce dont elle prit conscience en poursuivant ses études secondaires dans ce pensionnat religieux de la ville de Saint-Flour où elle côtoya les filles de la bourgeoisie.
Une auteure qui fut d'emblée acculée à l'exil pour survivre, et pour s'élever.
L'origine de l'écriture

Gustave Courbet, L'origine du monde
Au commencement le monde est fendu. Au commencement il y a la fente, la Santoire et sa mouillure vive au fond de la vallée qu'elle a creusée.
( Traversée)
Marie-Hélène Lafon, si elle vit désormais dans un autre monde à Paris tout en portant encore en elle son monde premier, habite pleinement le pays fabuleux de l'écriture où on peut «tout embrasser» sans renoncer à rien, Elle a réussi cet arrachement et cette transplantation du limon originel au terreau de l'écriture, cette sorte de double transmutation (5) où le corps d'un pays et son propre corps se muent en corpus textuel, avec toute la connotation sexuelle et religieuse que cela comporte, tandis que le texte passe par le tamis du corps.

Comme de la faille d'un volcan s'écoule la lave, ou de la fente originelle s'écoulent les eaux de la Santoire, cette coulée primordiale implacable de l'écriture «n'en finit pas de s'extraire» de «la fente féconde de la plaie textuelle». Et c'est bien dans cet entre-deux que se tient Marie-Hélène Lafon, dont l'écriture à mon sens une parenté certaine avec celle d'un autre écrivain des lisières, Mathieu Riboulet : le corps et le verbe souverains.
4) Le système temporel à l'oeuvre dans l'écriture permet notamment de mêler voie active et passive et le merveilleux mode conditionnel ouvre tous les possibles même dans un passé révolu ...
5) cf dernier paragraphe de la chronique
C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche.
(Pierre Soulages)
Le travail
"Travail" est peut-être le maître-mot chez Marie-Hélène Lafon, terme polyvalent riche de connotations évoquant tant le travail du temps et la torture que l'énergie, le geste, l'accouchement ou la création...
L'auteure se définit volontiers comme une "travailleuse du verbe" effectuant un «travail de terrassier et de terrain». Agrégée de grammaire, elle semble moins se considérer comme une intellectuelle que comme une manuelle en prise directe avec la matière. Pas un architecte concevant un projet mais plutôt un artisan-maçon maîtrisant parfaitement ses outils. Chez elle, c'est le faire qui prime, comme chez Pierre Soulages cité en exergue du livre. Et avec apparemment (6) beaucoup de modestie, elle réfute l'idée d'inspiration et de talent : elle ne croit qu'au patient "travail d'établi", à ce combat sans cesse recommencé, ardu mais «jubilatoire», qu'est ce «corps à corps avec les mots». Un travail pour extraire le fruit de ses entrailles, pour «extrailler». Pour s'élever et s'ériger en accouchant sans cesse d'elle-même.
Et on pourrait compléter cette vision en citant un autre peintre, Francis Bacon, qui disait : "Je travaille, je n'essaie pas de dire quelque chose, j'essaie de faire, je travaille pour moi, pour m'exciter moi-même". Travailler, c'est en effet pour elle «à la fois se mettre à la torture et entrer dans l'énergie» (le "tripalium" latin plus l'"ergon" grec), «on se prend en main et on s'empoigne. L'étymologie tourne à l'orgie». Le travail associe ainsi douleur et jouissance : l'auteure «crucifie la lettre» dans «une crucifixion délicieuse».
6) cf ci-dessous ( avant-dernier §)
/image%2F1338740%2F20230807%2Fob_8b14a1_duerer.jpg)
Plus encore q'un «sujet», la disparition semble le fondement-même de l'écriture de Marie-Hélène Lafon. utilité, de puissance, de raison d'être de ce monde dont elle est issue et la conscience aiguë de sa propre finitude fonderaient ainsi son écriture qui est aussi «sa façon d'être au monde» : «On écrirait pour vivre, pour élargir la vie».
Ecrire traduirait ainsi chez elle à la fois un refus de subir la contingence pour construire une nécessité, une justification de l'être, et un désir d'échapper à l'éphémère, un désir d'inaltérable. Ce serait rendre essentiel ce pays perdu, le faire exister à nouveau mais aussi se mettre toute entière dans son écriture pour exister soi-même. Une manière de sauver un monde et de se sauver : une fuite (toujours avancer), rassurante car se dirigeant vers un horizon sans cesse repoussé, et une renaissance infinie (toujours réinventer, se réinventer).
Cette écriture n'est pas héritage - l'auteure vient d'un monde où les mots servent à désigner l'utile et à parler des autres; jamais à se dire, et encore moins à se faire. C'est une écriture choisie, durement conquise car pour l'auteure ce n'était «pas du rôti», et qui semble confiner au sacré sans pour autant relever du don, de la grâce. Elle relève en effet d'abord de son travail, de cette puissance de vie qui la traverse et qu'elle met en branle, de son pouvoir créateur. D'où cette apparente modestie de "besogneuse" qui est plus à mon sens une fierté retrouvée. Une fierté légitime qui n'est pas vanité.
Le champ sémantique du sacré - empruntant au lexique catholique de la culture où elle a baigné -, souvent entremêlé au sexuel, est prégnant dans nombre de ces textes. Et Marie-Hélène Lafon célèbre elle-même le mystère dans ses propres liturgies dont le point culminant semble la lecture à voix haute : «Je lis comme on dit la messe». Par cet «exercice crucial et charnel de la lecture à voix haute», l'auteure semble ainsi communier avec elle-même et avec ses lecteurs, dans la jouissance et l'offrande du corpus textuel : dans une sorte d'actualisation du sacrifice rédempteur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_Lafon
On peut lire sur ce blog la critique et quelques extraits de Gordana et d'Album
TABLE DES MATIERES
C'est pas du rôti, 9
Papa lit. Maman coud, 19
Ceci est mon corps, 31
Le temps c'est de la mort, 41
Le cri de la Callas, 51
Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats, 61
Avançons, 73
Flaubert for ever, 89
A quatre mains, 105
C'est pas du rôti
p.11
(...)
La fille, cette fille, a étudié le latin et le grec. Elle a appris l'étymologie de humilié. Elle sait que humilié, étymologiquement, veut dire qui est au sol, à terre, humus le sol en latin, comme dans inhumer et exhumer, et posthume; au sol, sur la terre, dans la terre, plantée dans la terre comme un arbre. Depuis toujours, depuis qu'elle a pris conscience d'être, elle se sent comme ça, plantée en terre comme un arbre, comme l'érable dans la cour de la ferme; la balançoire est sous l'érable et on se jette dans l'érable les soirs d'été, on se jette de toute la force du corps d'enfance contre le vitrail mouvant de l'érable tout tailladé de verts et de bleus; elle se sent plantée en terre comme l'érable de la cour, cet érable, ou comme les frênes au bord de la Santoire, ou comme certain hêtre du pré dit pré de l'Arbre qu'elle connaît mieux qu'une personne et qui la connaît mieux que personne, muettement, depuis toujours, très très longtemps avant de se frotter au latin et d'être frottée de latin, très très longtemps avant de lire Flaubert et Homère, elle a eu cette histoire avec les arbres en particulier, et avec le pays, voire le paysage, voire les paysages en général.
(...)
Papa lit. Maman coud.
p.26
(...)Le conditionnel serait le ministre plénipotentiaire de la langue française, une sorte de diplomate infatigable, éminence grise des causes pas encore tout à fait perdues, expert en nuances rares et tournures obsolètes, taillé pour faire avaler forces pilules amères et autres couleuvres dodues. Le conditionnel, autrement dit forme en -rais, vous réconcilie en un tour de main, et sans effet de manche inutile, radical du futur et terminaisons de l'imparfait; il prend sous le duvet de son aile futur et passé, apprivoisés, réconciliés, épousés, accolés, encordés. Il noue et dénoue les rubans du temps. Pas vu pas pris, il est passé par ici, il repassera par là, et dans le sillage de son passé flotte le parfum ineffable des occasions manquées et des possibles abolis, on aurait aimé, on aurait vécu, on aurait chanté il aurait fait beau on n'aurait pas pleuré il ne serait pas mort et elle ne serait pas partie.
(...)
Ceci est mon corps
p. 36/38
(...) Le corps dans l'écriture et le corps à corps de l'écriture, c'est aussi cet exercice crucial et charnel de la lecture à voix haute. Je ne sais rien faire d'autre pour ajuster le tir verbal que de lire à voix haute, recommencer, relire et redire, et donc émettre le texte par le corps, avec lui, soumettre le texte au risque de l'air, de sa densité, le tendre, le pousser, l'ériger, le respirer, le humer, l'expectorer. Il faudrait écrire extrailler qui serait tellement meilleur qu'extraire parce qu'il dirait aussi les entrailles, les entrailles susmentionnées, les mariales et les autres, les miennes aussi, d'où ça sort et d'où ça monte, puisque cette respiration-là, celle des textes, comme celle du chant, part du ventre, et monte, prenant tout le corps, le mettant en jeu et en branle, le traversant littéralement, d'où le tamis, qui suppose aussi du geste, un ébranlement, un recommencement, une ténacité.
Le tamis du corps ne suffit pas, il faut dire le tamis des corps, parce que le corps du lecteur est aussi en jeu; la phrase est tendue et travaillée pour lui rentrer dedans, pour rentrer dans les lecteurs, leur faire perdre et chercher, perdre ou chercher, rechercher, recouvrer leur respiration, et leur souffle. (...)
D'où le goût invétéré que j'ai des rencontres avec les lecteurs, qui sont souvent des lectrices. (...) Je dis volontiers que je lis comme on dit la messe; c'est assez sacerdotal et la boucle se boucle; j'usurpe la place du desservant mâle, je l'occupe, cette place devient ma place; et j'érige le texte et je le délivre, et je l'administre, je l'expectore, je l'extraille; alors je vois, alors je sens, comment le texte tient, s'il tient, s'il touche, s'il avance son étrave dans les corps, s'ils sont pris, si les lecteurs sont pris, et comment ils le sont. C'est du travail.
(...)

/image%2F1338740%2F20230416%2Fob_2c3a4f_31shqkh0gzl-sx210.jpg)


