"Ziyan", de Hakan Günday
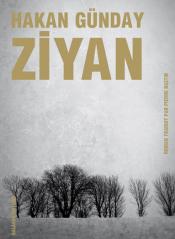
Publié en 2009 et sorti dans sa version française début 2014, ce roman d'Hakan Günday, jeune et prolixe écrivain turc considéré comme le plus prometteur de sa génération, est un livre magnifique, un livre choc qui n'exclut pas pour autant profondeur ni finesse.
Parti de son expérience du service militaire obligatoire - réalité avec laquelle on doit vivre dans son pays, l'objection de conscience n'y étant pas légalisée -, Ziyan doit beaucoup également à la fascination de l'auteur pour un parlementaire oublié de la toute jeune république de Turquie, un certain Ziya Hursit condamné à mort à 26 ans pour une tentative d'attentat contre Atatürk, et qu'il découvrira être un de ses ancêtres.
Ziyan, qui en turc signifie à la fois "gâchis" et "ton Ziya"(l'auteur aime jouer sur les mots), est d'abord une féroce satire de l'armée dénonçant cette violence dont personne ne parle qui est endurée au quotidien par tous les conscrits. Hakan Günday, s'inspirant en partie de Full Metal Jacket, le célèbre film de Stanley Kubrick, décrit toute cette agitation, cette énergie inutile déployée lors de ce service militaire avec une précision implacable et une noire dérision en la concentrant dans un espace restreint. Et il retrace aussi, dans une tonalité différente, le court parcours de son personnage quasi éponyme, de l'enfer d'une première guerre mondiale affrontée très jeune à ce geste, à cette décision fatale qu'il tente d'interpréter. Il laisse ainsi courir son imagination pour combler les vides tout en remémorant un pan d'histoire de la Turquie, en interrogeant cette période où s'érigea l'icône du «père de la nation», en interrogeant plus largement le gâchis de nos vies et l'absurdité de notre monde.

( Full Metal Jacket, film de Stanley Kubrick , 1987)
Dans une région orientale reculée au dur climat, où l'hiver semble interminable, figeant des paysages qui vous enferment comme les murs d'une prison, l'armée contrôle les populations kurdes. Et les jeunes soldats qui y sont abandonnés à sa hiérarchie font l'objet d'un conditionnement intensif relevant des techniques de redressement les plus destructrices. Au moindre signe de rébellion et même de "visibilité", ils rejoignent la horde des damnés parmi les damnés, celle des «soldats d'Ekber» - «un type comme une feuille de carbone qui décalquait l'art de la guerre sur le sadisme». Insultes, vexations et brimades, «danse du commando» ou délirante «remise à zéro» où les anciens font ramper les «bleus» sous les coups en les transformant en véritable «serpillière humaine» -, ce harcèlement continuel s'abat sur les conscrits dès leur arrivée, broyant les individus pour en faire «les chenilles d'un gigantesque char», poussant certains à la folie, à l'automutilation, au crime ou au suicide.
Au sein de l'unité militaire à l'arrière des affrontements avec les rebelles du PKK et quasiment hors de contrôle qui nous est décrite, cette absurde mécanique tourne à vide et tous les règlements sont bafoués dans la pratique : il n'y a pas de limite à l'oppression de son semblable par le supérieur hiérarchique dans cette chaîne de commandement qui s'apparente plus à une «chaîne alimentaire». Et ceci permet de mieux saisir l'essence-même de ce conditionnement reposant sur la peur.
Car c'est avant tout la peur qu'Hakan Günday questionne, tentant de comprendre, au-delà du cri de colère et de désespoir dont il se déleste, les véritables règles régissant non seulement l'armée, la république et la société turques dont elle est le socle, mais aussi toute société humaine. Et il débouche alors sur un questionnement philosophique encore plus large - et visiblement influencé par Nietzsche -, se situant à une autre échelle. Il prend ainsi la mesure de l'homme et de la vie à l'aune de la mort, celle de notre existence au regard de l'éternel néant, ramenant chacun d'entre nous à des questions essentielles : Que faire de cette vie éphémère qui nous est donnée ? Doit on se risquer à l'accepter ? Et que deviennent ces rêves qui font vivre ?

Hamlet devant le crâne de Yorik
(Shakespeare 1601, film de Kenneth Branagh 1996)
L'auteur confie le récit à un jeune soldat qui a peur de tout et qui, épouvanté par sa vie, a peur de se tuer : «Je voulais mourir. (...) Je voulais m'enfouir dans la neige et geler». Et il varie et complexifie la narration en faisant intervenir très habilement, dans un jeu d'échos et de miroir, le personnage de Ziya qui, lui, a toujours ignoré la peur. Lors de nombreux tours de garde solitaires vécus comme un véritable supplice dans les nuits glaciales, le mort va venir hanter un héros en proie à l'insomnie et à l'hypothermie, lui semblant d'abord une terrifiante hallucination témoignant de sa folie. Un spectre sollicitant aussi l'imaginaire du lecteur et le renvoyant à la célèbre tirade d'Hamlet.
Le parcours de ce fantôme désireux de conter sa propre histoire mais aussi de sauver le héros, va s'encastrer alors dans le parcours militaire du jeune conscrit qui, de déflagrations (parfois soulignées par la typographie) en lignes franchies jusqu'au paroxysme d'une nuit de nouvel an, s'achemine de seuil en seuil au plus profond de sa nuit, jusqu'à son ultime libération. L'entrelacement de ces deux parcours met le soldat face à sa propre histoire, éclaire sa difficulté à vivre. Car il ne faut pas s'enfermer dans une alternative : être «opprimé, avec des douleurs imbéciles; ou (...) opprimant avec des joies idiotes».
Pour accepter vraiment la vie il faut s'arracher du troupeau, des troupeaux : de celui des moutons mais aussi des bergers. Et cette voix qui interpelle le héros, le raille et le provoque, le critique ou l'exhorte, le conseille et le soutient, semble venir de l'intérieur comme s'il avait «avalé un essaim d'abeilles». Elle résonne comme le réveil de sa conscience, comme le dégel de l'âme, lui révélant que toute vie libre se joue sur le «seuil du suicide», «dans la fissure entre la mort et la vie», et lui ouvrant «une porte vers l'inconnu». L'horizon aussi d'une page blanche à noircir, comme une «route noire» s'élevant «dans le blanc d'une photo à deux dimensions».
Hakan Günday peut ainsi approfondir son questionnement sur l'homme au travers du dédoublement de son héros et réfléchir sur deux temps en instaurant un riche dialogue entre la réalité présente et un passé déjà lointain. Un double point de vue narratif lui permettant également de s'interroger sur la portée des actes, des décisions des hommes, avec le recul nécessaire tout en accentuant le brouillage entre songe et réalité qui renforce cette sensation de dilution du temps résultant de ces paysages de neige où la blancheur de la terre s'estompe dans le blanc du ciel.
Et l'on est emporté par le souffle et l'intensité de l'écriture. Une écriture qui claque, qui avance et qui interpelle mais dans un temps semblant en suspens. Une écriture tendue dont les phrases courtes souvent haletantes contrastent avec l'immobilité induite par le champ sémantique dans lequel puise l'auteur pour nous faire ressentir l'a-temporalité de ces paysages neigeux ou la glaciale obscurité des nuits silencieuses. Une langue souvent orale, brutale mais aussi poétique, dont le rythme rapide alterne la syncope de l'ellipse et l'élan de la reprise, une langue profondément métaphorique dont la puissance et la beauté des images touchent intensément.

Correggio, "Ecce Homo", 1525-1530
L'histoire imaginée par l'auteur, le propos qu'il y tient et la forme s'épousent ainsi intimement, magistralement, ce que confirme encore la pertinence d'un découpage narratif d'une grande originalité.
Après un court prologue où un narrateur extérieur s'invite sur un champ de bataille au début des années 1910, ce récit d'un service militaire s'amorce sur le héros narrateur contemplant la photo du "Gazi" ("le Victorieux", surnom donné à Atatürk), introduisant d'emblée la confrontation des deux époques dont l'une reste désormais figée dans un cliché en noir et blanc gardant tout son mystère. Un récit divisé en dix chapitres d'inégale longueur et curieusement notés de 10 à 0 ! Décompte évoquant bien sûr la "quille" d'un soldat dont le service s'avère «une remise à zéro générale de l'individu» mais aussi le lancement d'une fusée vers un univers inconnu...
Puis le livre se prolonge encore sur quelques pages, comme en accéléré, continuant le décompte au-dessous de zéro car «tout commence en dessous de zéro. Quand on enfile les masques de neige, les vrais visages apparaissent». Un livre qui nous donne en effet à voir l'homme dans sa noirceur et sa lumière, mais aussi cet homme «condamné à mort parce qu'il a incité la population à la révolte» : «Ecce homo», «Ecce Ziya».
Et c'est un narrateur extérieur surplombant qui, des chapitres -1 à -23 (parfois réduits à quelques lignes ou à une page blanche), reprend la parole, introduisant du recul sur cette histoire contée avec vivacité dans l'incarnation d'un double "je". Introduisant le recul du temps, celui de la mort qui tour à tour nous fera disparaître sans que pour autant la terre ne s'arrête de tourner (on comprend peut-être alors pourquoi l'auteur s'est arrêté au nombre 23).
«Tout se termine en dessous de zéro. Quand les rêves aussi se transforment en poudre de glace».
(Article pulblié dans La Cause littéraire le 05/11/14)

Ziyan, Hakan Günday, traduit du turc par Pierre Bastin, Galaade éditions, février 2014 (Dogan Kytap, 2009), 348 p.
A propos de l'auteur :
Né en 1976, Hakan Günday est le plus connu des écrivains turcs de sa génération. Francophone pour avoir suivi dans sa jeunesse son père diplomate à Bruxelles et dans nombre de pays d'Europe, il a fait des études littéraires et politiques. Grand lecteur, il a été profondément marqué par Voyage au bout de la nuit de Céline.
Il est déjà l'auteur de huit romans.
Ziyan, après D'un extrème l'autre (Galaade 2013) – qui a reçu le prix du meilleur roman de l'année 2011 en Turquie – est son deuxième livre traduit en français.
EXTRAITS :
10
p. 16/17
(...)
Mais moi, je pouvais entendre. J'entendais la voix qui sortait de la photo. Peut-être que ce que j'entendais, c'était une voix qui sortait de mes yeux et qui, frappant la photo, me revenait comme un écho. Ma propre voix. Moi... Selon Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Mais pas n'importe quel homme. La mesure de toute chose, c'est l'homme qui la mesure. Et moi, en regardant le visage du Gazi et la manière dont il était couché, je me voyais moi-même. Parce que, les rares moments où j'avais l'occasion de m'étendre sur ma couchette étroite, je disparaissais sous ma couverture et j'avais envie de mourir. Pour ne plus voir ni entendre personne. Pourtant, c'était impossible. Le service militaire obligatoire n'était pas un one man show, mais une pièce mettant en scène des milliers d'acteurs. Une représentation où les soldats étaient non seulement acteurs mais spectateurs. Les exercices de formation en ordre serré figuraient une chorégraphie, les marches une comédie musicale. Le treillis était un costume ajusté au millimètre et les ordres, les questions, les réponses, les répliques à apprendre par coeur. Le scénario auquel on n'était jamais fidèle était écrit dans les directives et le metteur en scène, on l'appelait «mon commandant». Il y avait tout et tout était prêt. Pourtant, toutes ces choses faisaient trop de bruit. Trop, au point de ne pas les supporter. Trop, au point de vouloir déchirer le lit et s'y enfouir. Trop, au point de vouloir remplir l'oreiller avec ma tête. Trop, au point de me voir en regardant le Gazi!
«Tu es de garde.»
La phrase se vrilla dans mes oreilles et j'ouvris les yeux, revenu à la vie. En passant devant le sergent en faction de nuit, je sortis de la cantine. Dès mon premier pas, mon nez se mouilla : la neige. La neige qui, à force de frapper mon visage, fondait et me glaçait la face. Cela faisait des mois qu'il neigeait. La nuit, le jour, le matin, le midi, avant, après. Il neigeait à ensevelir. Tout et tout le monde. Les voitures, les enfants, les maisons, le bétail. Aux informations, on parlait du niveau de neige propre à la pratique du ski! Le niveau de neige? Idéal pour le ski? Bien, et était-il idéal pour que les misérables charognes vivant dans les villages aux routes recouvertes par la neige, pauvres ombres qui restaient muettes quand leurs enfants d'un an crevaient comme des mouches, traversent en traîneau le mont Fatiha ou prennent la route de Van pour sauver des ancêtres aussi âgés que Mathusalem? Le niveau de neige? D'abord les pieds s'enfoncent, ensuite les chevilles disparaissent, puis les genoux, les jambes ... La neige enterre vivant.
D'abord, tu combats avec tes poings. Pour renvoyer la neige d'où elle vient, tu remplis tes poings et tu la jettes en l'air. Après, c'est à la pelle. Une pelle pour vingt soldats. Un outil pour vingt bras. Peut-être une pioche faite d'un vieux manche de marteau. Tu creuses! Tu pioches! La neige tombe. Jusqu'à t'ensevelir. La pluie tombe, jusqu'à te noyer. Le vent souffle, jusqu'à te faire tomber. Si tu écoutes bien, tu entends le monde : humain, fils d'humain, dégage d'ici! Mais tu t'obstines. Tu vivras. La pesanteur te tient. Nulle part où aller. Traqué sans cesse, tu n'as d'autre choix que de vivre sur cette terre qui tremble et s'ouvre pour t'avaler. Mars est très loin! La vie de l'homme en ce monde : un rodéo. Tornades, avalanches, inondations, séismes... La pelle à la main, tu combats. «Ici, c'est ma maison», hurles-tu. Mon cul! Ici ce n'est pas une maison! Ici, ce n'est rien du tout! Le monde n'est pas la carapace de l'homme. La Terre n'est pas notre foyer, seule la pesanteur nous enchaîne ici-bas. Qui sait d'où nous avons été chassés? Du Paradis? Je ne le pense pas! Absolument pas!
(...)
p. 71/72
(...)
«Le colonel arrive. Il faut déblayer la neige de son passage et casser la glace.»
Je cassais, puisque la différence entre l'animal et l'homme réside dans le fait que ce dernier utilise des outils. Au premier rang desquels venait un autre homme : moi! J'étais même prêt à exécuter des ordres qui n'avaient pas été donnés. J'étais coincé entre la terre et le ciel, entre deux blancheurs. J'avais été pressé. Comme une dose de shit. Comme un silex dans une boule de neige. Je cherchais une tête à fendre. Mais la seule chose qui saignait, c'étaient mes mains. Mes mains qui portaient, nettoyaient, gelaient, dénouaient, avec lesquelles je me caressais les parties, qui saluaient. Mes mains avec lesquelles je me bouchais les oreilles, me protégeais le visage, m'étranglais. Les lignes sur mes paumes étaient devenues plus profondes et des rivières sombres coulaient dans les fissures. Des deltas d'un noir d'encre. Moi je coulais, et les eaux ne cessaient de monter. Ni l'avenir ni le destin, rien ne s'y lisait. Leur peau élargie était râpée, leurs ongles éclatés, brisés. Mais on s'en foutait. Moi et mes mains. Nous ne criions pas, ne pleurions pas, ne poussions pas un concert de cris stridents. Parce que nous savions que le silence était nécessaire. Nécessaire pour penser. Penser au mort. Mais les autres l'ignoraient. Pour cette raison, ils parlaient. Aux heures où les ordres se faisaient plus rares, ils parlaient à s'en faire crever les tympans, en hurlant.
Les soldats parlent en ouvrant la bouche grand comme leur cul. Ils hululent. Constamment. Même dans la cellule. Même en dormant. Parce qu'ils grognent. Comme des animaux mécontents. Ils ne murmurent jamais. Comme s'ils n'avaient jamais murmuré. Pourtant ils doivent se souvenir...qu'à leur naissance on a murmuré leur nom. (...)

Rembrant, Ecce Homo, pointe sèche, 1655
8
p.228/229
(...) Je voyais cette scène. Rembrant, Ciseri, Le Corrège. Beaucoup de tableaux d'autres peintres aussi. Je les voyai sur des murs. Suspendus à de grands murs. Des tableaux sur des murs qui ne pouvaient appartenir qu'à un musée. Tous différents. Tous bizarres. Come toujours. Ainsi que Ziya l'avait dit : «L'homme n'est pas une créature qui sait se souvenir.» Ensuite tout s'effaça et le visage de Grotz apparut devant mes yeux qui regardaient au loin la place d'appel. Cette fois, je pensais à ces tableaux.
«J'aurais voulu voir ces tableaux. Peut-être y figurais-tu dans un coin. Ensuite ? Tu as pu retourner à Eskisehir ?
- Cette semaine-là, je pris la route, avec sur moi le quart des dons faits au bureau berlinois du parti communiste allemand. A dix-heuf ans, je commencerais ma propre guerre et je tuerais tous les Anglais que je rencontrerais. J'allais faire éclater avec leur tête la porte de la cellule où ils retenaient mon père. D'abord Leipzig, ensuite Prague. Après, Bratislava, Budapest... Ma haine grandissait à mesure que s'approchait le terme de mon voyage. Mon humanité fondait à chaque gare que le train laissait. En arrivant à Belgrade, je jurai de tuer le gardien de mon père de mes propres mains. Qui que ce soit, je l'étranglerai de mes mains. A Sofia je rêvais de couper la gorge à tous les soldats qui occupaient l'Anatolie. Sur le chemin d'Athènes à la Crète, je ne voyais plus, n'entendais plus, ne parlais plus. J'étais un rasoir aiguisé sur la haine. Si tranchant qu'il aurait pu déchirer le bateau sur lequel je montai. Quand je débarquai, à Aydin, il faisait nuit et je trouvai mon chemin aux flammes qui me sortaient des yeux.
- La sentinelle viens, je dois y aller.»
Il ne regardait pas mon visage. Il devait voir son père. Il se voyait en train d'étrangler le gardien de son père. Il était là-bas. A Leipzig, à Sofia, à Aydin. Où qu'il soit, il tremblait. Incandescent au point de faire fondre la neige. Clairement, il souffrait jusqu'à la racine des poumons. Le souffle qu'il portait en lui sortait de sa bouche en insultes. S'il avait une âme, elle palpitait comme le soufflet d'une forge. Le soldat de garde, choisi parmi les nouveaux, s'était approché et me considérait. Il essayait de comprendre ce que je regardais. Pourquoi je restais immobile sous la neige. Moi aussi, j'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre si l'homme qui se tenait devant moi, tremblant comme si on l'avait torturé, et qui m'incitait à la révolte, était un provocateur ou un messie venu me sauver. Le soldat à côté de moi pouvait-il m'aider? Je tentai ma chance. Désignant le mort d'un doigt qui dépassait de mes gants déchirés, je dis :
«Ecce Ziya !»

