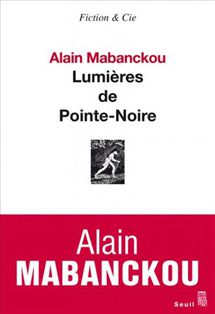"Lumières de Pointe-Noire", de Alain Mabanckou
Vingt-trois ans après avoir quitté sa ville natale pour la France puis les Etats-Unis, et alors qu'il n'y était pas retourné pour l'enterrement de sa mère qu'il ne vit pas vieillir, ni pour celui de ce père qui l'adopta avec générosité, Alain Mabanckou accepta en juin 2012 l'invitation de l'Institut français de Pointe-Noire à venir donner quelques conférences, décidant de prolonger son séjour pour voir toute sa famille et écrire ce livre qu'il intitulera Lumières de Pointe-Noire .

Pointe-Noire
Le temps a passé : les gens ont vieilli ou disparu, beaucoup de choses et de lieux ont changé et l'auteur lui-même n'est plus celui qu'il était. Et si ce récit d'un retour au pays natal résonne d'abord comme un hommage à ceux à qui il doit tant, à sa mère, à son père et à sa famille, c'est aussi la reconnaissance identitaire d'un homme et d'un écrivain renouant avec son origine et célébrant ces racines qui constituent le fondement de sa personnalité adulte et de son écriture, ce qu'annonce d'emblée l'épigraphe :
«Maintenant les heures murissent
sur l'arbre du retour
pendant que l'assoupissement
convoite les paupières
accablées par la poussière des regrets
un gamin va naître jadis»


Le Lycée de Pointe-Noire
Pointe-Noire, l'hôpital Adolphe- Sicé

Lumières de Pointe-Noire, Alain Mabanckou, Seuil, janvier 2013, 286 p.
A propos de l'auteur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Mabanckou
A propos de la photographe :
https://carolineblache.wordpress.com/pointe-noire-congo-2012/
(On peut voir sur ce site ses photos de Pointe-Noire et notamment toutes celles qui sont reprises dans le livre)
EXTRAITS :
Première semaine
Les enfants du paradis
p.138/139
(...) Ces enfants, eux, savent, à travers la rudesse de l'existence, trouver les points de lumière. J'ai mis du temps avant de comprendre qu'ils étaient tout aussi heureux que je l'étais lorsque j'avais leur âge et que le bonheur était dans le plat qui fumait dans la cuisine, dans l'herbe qui poussait, dans le pépiement d'un couple d'oiseaux amoureux, voire sur l'affiche d'un film indien projeté au cinéma Rex où nous nous alignions dès dix heures du matin por avoir des chances d'assister à la séance de quinze heures. Nous étions loin des tracasseries de nos parents en qui, de toute façon, nous avions confiance car ils savaient maquiller leurs angoisses, leurs manques, leurs difficultés à joindre les deux bouts de mois pour ne pas entacher notre innocence.
Pensant à cette enfance où nous nous cachions dans les champs de lantanas près de l'aéroport Agostinho-Neto et traquions les coléoptères aux mille couleurs quand nous ne pêchions pas des fretins depuis une des rives de la Tchinouka, j'ai répondu à cet ami habité par son arrogance de «Nègre à Paris » :
- Mes petits ne sont pas dans un paradis de misère, regarde bien la photo : leur bonheur est dans ces pneus et dans ces tongs... Les tongs pour marcher, les pneus pour tous prendre une moto qu'ils imaginent si gigantesque qu'elle pourrait contenir leurs rêves les plus extravagants. (...)
Dernière semaine
Le cercle des poètes disparus
p. 236/237
(...)
Je me souviens que dans ce lycée, j'avais le sentiment d'avoir été parachuté dans un monde différent tel un oisillon inquiet égaré au milieu d'autres espèces de volatiles au pennage déjà endurci. Je m'abritais d'ordinaire à l'ombre des cocotiers de la cour centrale en attendant la sonnerie de la fin de la récréation.
En classe, pendant les premières semaines, convaincu que je n'avais pas le niveau de mes camarades, je m'installais au fond de la salle, jusqu'au jour où le professeur de chimie – une matière que je redoutais – me somma de rejoindre le premier rang parce que, argua-t-il, ma grande taille était appropriée pour l'aider à exhiber les éprouvettes lors des travaux pratiques. Je venais d'avoir seize ans et, à la différence de certains élèves de mon âge qui se liguaient contre leurs parents, ma crise d'adolescence s'extériorisait plutôt par une voix qui me chuchotait que l'enseignement secondaire me détacherait de ma famille puisque c'était dès le lycée que s'opérait la sélection de ceux qui un jour partiraient ailleurs, loin de leur pays pour ne plus revenir. Cette impression était amplifiée par l'océan Atlantique juste derrière l'enclos de l'école et le vent qui secouait les cocotiers de la cour centrale. Voir en permanence la mer, les marins polonais et leurs tatouages grossiers, les pêcheurs béninois excités par une pêche abondante, les albatros apeurés par la hauteur des vagues et les navires amarrés au port avec leurs voiles épuisées me détachait peu à peu de cette ville. Au fond, je couvais le rêve de partir sans savoir où, comment ni quand. Je voulais être solitaire au milieu de la foule, invisible là où je dépassais mes camarades d'une bone tête alors que je comptais parmi les plus jeunes.
Parfois, afin d'échapper aux quolibets, une heure avant les cours, j'errais pieds nus sur la grève. Après avoir marché pendant quelques minutes je rebroussais chemin en m'appliquant à poser le pied là où j'avais auparavant laissé des trraces. Je savais que les élèves qui passeraient plus tard par là seraient affolés et s'imagineraient qu'un monstre marin mi-homme mi-animal rôdait dans les parages avec ses pieds aux orteils devant et derrière qui lui servaient à semer ceux qui songeraient à le traquer. Ces élèves décamperaient en hurlant de toutes leurs forces pendant que moi, dans mon coin, je contiendrais mon rire le plus fou...
(...)